L’habitat partagé connaît un développement croissant en Belgique. Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs : la pression immobilière dans les grandes villes, la volonté d’optimiser les espaces de vie, mais également l’attrait pour une certaine convivialité.
La colocation : un régime juridique encadré
En Région wallonne comme en Région de Bruxelles-Capitale, la colocation bénéficie d’un statut légal spécifique, prévu par le décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation et le Code bruxellois du logement.
En Région wallonne, le bail de colocation est défini comme « la location d'un même bien par plusieurs colocataires ayant signé un pacte de colocation au plus tard à la signature du contrat de bail et dont la date de signature est reprise dans le contrat de bail. Il est formalisé par la conclusion d'un contrat unique entre les colocataires et le bailleur. L'habitation prise en location comprend au minimum une pièce d'habitation ou un local sanitaire commun à tous les colocataires. ».
En Région de Bruxelles-Capitale, ce bail est défini comme « la location d'un même logement par plusieurs preneurs qui optent, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, pour l'application du régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation tel que prévu par l'article 261, formalisée par la conclusion d'un seul contrat entre les preneurs et le bailleur. ».
L’élément qui permet aisément de distinguer le bail de colocation des autres baux d’habitation est l’existence de deux « contrats » distincts : un unique contrat de bail de colocation signé entre le bailleur et les colocataires et un pacte de colocation signé entre les colocataires. Si l’un de ces deux contrats fait défaut, il y a de fortes chances de voir le contrat être requalifié autrement. Le bailleur ou les colocataires désireux de bénéficier du régime du bail de colocation doivent donc s’assurer de l’établissement et de la signature de ces deux documents.
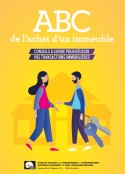
Le régime juridique de colocation est ainsi fondé sur un équilibre entre les droits et obligations du bailleur et ceux des colocataires. D’un côté, il offre au bailleur la solidarité entre les colocataires laquelle implique qu’en cas de défaillance d’un des colocataires, ce sont les autres colocataires qui devront en répondre à l’égard du bailleur. D’un autre côté, il offre aux colocataires la possibilité de se libérer du bail avant son terme, moyennant notification aux colocataires et au bailleur, un préavis de 3 mois et, au choix, son remplacement par un nouveau colocataire ou le paiement de 3 mois d’indemnités.
Ce régime présente l’avantage d’offrir au bailleur une sécurité juridique appréciable, dans la mesure où il devrait, en principe, toujours obtenir le paiement de la totalité de son loyer mais implique une gestion administrative plus étendue en cas de départ d’un ou de plusieurs colocataires, le régime n’étant pas particulièrement facile à appréhender.
En somme, le bailleur et les colocataires disposent de droits et obligations les uns vis-à-vis des autres et, dans le même temps, les colocataires disposent de droits et obligations entre eux.
Le coliving : une formule contractuelle plus souple mais non encadrée
Le coliving avec « contrats individuels »
Le coliving, pour sa part, ne bénéficie pas d’un cadre juridique spécifique. Il s’agit d’une formule d’habitat plus récente, qui repose en pratique sur l’application des règles générales du bail de résidence principale, du bail étudiant ou du bail d’habitation classique, selon la situation.
Dans ce modèle et à la différence du bail de colocation, chaque locataire dispose de son propre contrat de bail dont le sort est indépendant des baux conclus par les autres locataires. Dans le même ordre d’idées, ce type d’organisation juridique ne suppose aucune solidarité entre les différents locataires, chacun ne devant répondre que de ses propres obligations.
Cette formule peut s’avérer intéressante pour le propriétaire dans la mesure où elle permet de réduire les démarches de suivi en cas de départ d’un des locataires et permet de mettre fin au bail d’un locataire indépendamment des autres baux. Ces avantages sont toutefois contrebalancés par l’absence de solidarité entre les locataires.
Concrètement, le bailleur et chacun des locataires disposent de droits et obligations réciproques alors que les locataires ne disposent pas de droits et obligations contractuels entre eux.
Le coliving en « sous-location »
Une autre forme de coliving repose également sur le principe de la « sous-location ».
Dans ce modèle, le bailleur conclut un contrat de bail avec un locataire dit « principal » et lui octroie le droit de sous-louer tout ou partie des lieux à d’autres personnes, appelées les « sous-locataires ». Le locataire principal sera alors lié aux autres occupants par des baux de « sous-location ».
Ce modèle permet au bailleur de n’avoir qu’un seul interlocuteur et débiteur : le locataire principal. Cela permet de faciliter la gestion administrative et d’éviter au bailleur de supporter les conséquences de l’insolvabilité d’un des sous-locataires. En revanche, le bailleur se trouve particulièrement exposé en cas d’insolvabilité du locataire principal.
En parallèle, ce type de coliving fait peser, sur le locataire principal, l’insolvabilité éventuelle de chaque sous-locataire ainsi que le risque de vide locatif associé au départ de l’un d’eux. Quant aux sous-locataires, leur situation est identique à tout locataire classique.
Le bailleur dispose donc d’un seul interlocuteur : le locataire principal qui assure, à son tour, le rôle de « bailleur » vis-à-vis des sous-locataires.
Comparaison et choix stratégique pour le bailleur
En définitive, la colocation et le coliving offrent toutes deux des opportunités aux propriétaires, mais elles répondent à des logiques différentes. La colocation, plus classique, repose sur un régime juridique encadré, qui garantit une sécurité accrue mais implique une gestion parfois plus lourde. Le coliving, en revanche, ouvre la voie à une plus grande flexibilité, mais il s’accompagne d’une zone d’incertitude juridique et d’un degré de risque plus marqué, notamment en cas de défaut de paiement d’un des locataires.
Il appartient dès lors à chaque bailleur d’évaluer attentivement ses objectifs patrimoniaux et son appétence au risque avant d’opter pour l’une ou l’autre formule.
Dans tous les cas, il est conseillé au bailleur averti de se renseigner auprès de spécialistes dans le cadre du choix de la stratégie contractuelle à adopter et de s’assurer de la conformité urbanistique et du respect des normes de sécurité, ainsi que des implications fiscales propres à chaque formule.




